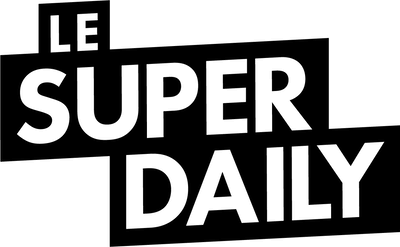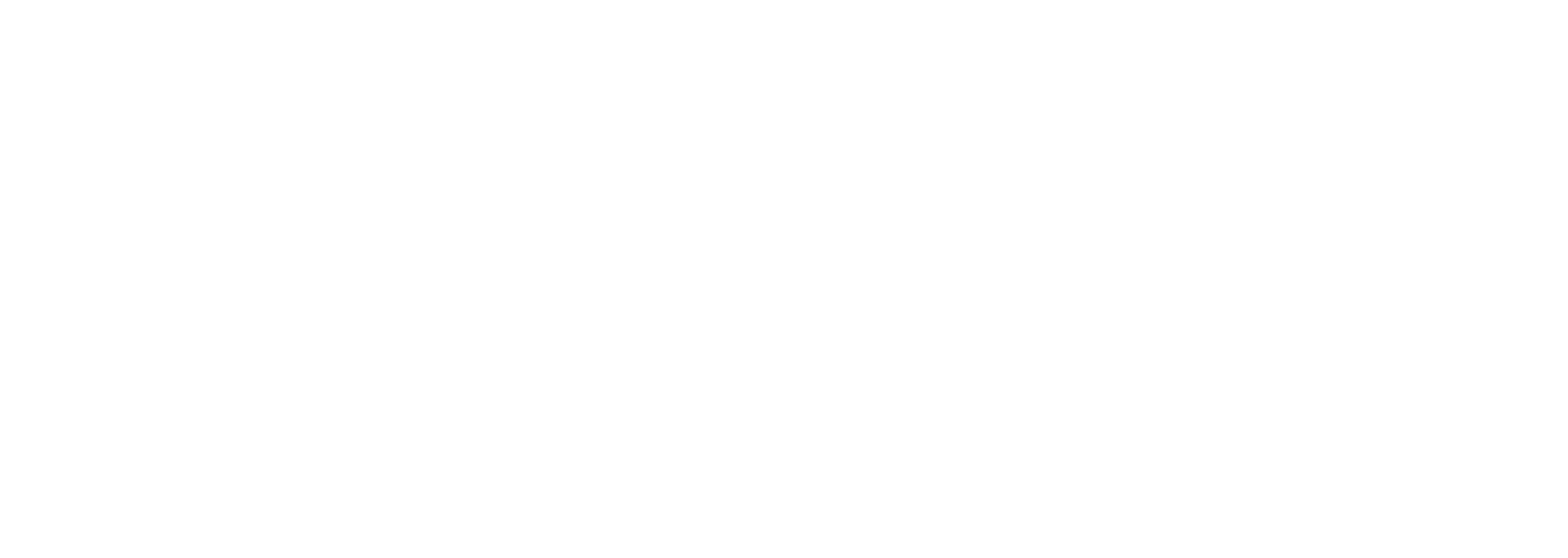Épisode 1377 : Les fondateurs du web l’avaient imaginé comme un réseau mondial, ouvert, interopérable, connecté et sans frontières. Mais en 2025, cette vision semble vaciller.
Aujourd’hui, les chiffres et les tendances confirment une fragmentation croissante d’Internet, influencée par des dynamiques géopolitiques, technologiques, économiques et culturelles.
Ce morcellement remet en cause l’universalité du web tel qu’on l’a connu, au profit d’écosystèmes cloisonnés, incompatibles, parfois souverains ou autoritaires.
📊 Partie 1 : Des signaux faibles qui deviennent évidents
Plusieurs indicateurs chiffrés soulignent cette fragmentation :
- 5,24 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde, mais avec des disparités régionales marquées :
- 97 % d’adoption en Asie de l’Est,
- à peine 3 à 10 % en Afrique centrale.
- Fragmentation de l’accès à l’information : en France, 19 % des internautes s’informent via les réseaux sociaux, contre 35 % au Brésil ou aux États-Unis.
- Le marché du Search est en ébullition :
- Google passe sous les 50 % de part de marché publicitaire aux États-Unis en 2024.
- Amazon progresse à 30 %, ChatGPT (OpenAI) à 4,33 % avec une croissance mensuelle de 13 %.
- Apparition de nouveaux protocoles réseau alternatifs comme IPv6+ ou New IP, initiés par la Chine, la Russie et l’Iran pour contourner l’architecture globale.
🌐 Partie 2 : Une fragmentation géopolitique et souveraine
La “balkanisation du web” est en marche :
- Chine (Great Firewall), Russie (RuNet), Iran (RIN) : chacun développe son propre Internet, contrôlé, surveillé, et en partie incompatible avec le reste du monde.
- Des pays comme l’Inde multiplient les coupures ciblées d’Internet pour des raisons politiques ou sécuritaires (167 coupures recensées en 2023).
- Les stratégies de souveraineté numérique se généralisent : localisation des données, restrictions d’infrastructure, normes nationales (cf. DORA, NIS2 en Europe).
⚙️ Partie 3 : Une fragmentation aussi technique et économique
Ce morcellement ne touche pas que la géopolitique :
- Prolifération des standards non compatibles : les géants du numérique développent chacun leur environnement fermé. Apple, Meta, Amazon ou Google construisent des jardins clos, interdisant l’échange fluide de données.
- Le Search devient conversationnel, multimodal, distribué sur plusieurs plateformes : Amazon, TikTok, YouTube, ChatGPT, Pinterest… Chaque plateforme capte un morceau du parcours utilisateur.
- La gestion des talents et des fournisseurs IT devient géographiquement sensible. Des stratégies de « friend-shoring » apparaissent : sous-traiter dans des pays alliés plutôt qu’à l’international.
⚖️ Partie 4 : Une fin… ou une transformation du web global ?
Mais tout n’est pas si tranché :
- Internet reste massivement utilisé dans le monde entier, malgré les barrières.
- Les grandes plateformes sociales globales maintiennent des ponts : TikTok/Douyin, YouTube, Instagram, WhatsApp, etc.
- Des formes d’interopérabilité et de gouvernance partagée continuent d’exister : déclarations internationales, initiatives diplomatiques (ex. : “Déclaration sur l’avenir d’Internet” par l’UE et les USA en 2022).
- Une tension constante entre logique de contrôle (national, technique, commercial) et besoin de connectivité globale (éducation, économie, innovation).
🧠 Partie 5 : Et pour les marques, ça change quoi ?
- Nécessité d’adapter les stratégies digitales aux réalités locales : régulations, habitudes culturelles, plateformes dominantes.
- Anticiper les barrières technologiques ou géopolitiques : certains services ou plateformes pourraient devenir inaccessibles dans certaines régions.
- Investir dans des écosystèmes hybrides et flexibles : cloud souverain, versions locales d’apps, respect des standards nationaux.
- Mieux cartographier ses audiences : l’universalité n’est plus acquise, il faut raisonner par zones de connectivité.
⚖️ Partie 6 : Le Web social sous contrôle des États — Vers des réseaux “nationaux”
Le web social mondial n’existe plus vraiment. Aujourd’hui, chaque région du monde légifère son propre Internet, avec des exigences souvent contradictoires, forçant les plateformes à s’adapter localement ou à se retirer de certains marchés.
🇨🇳 Chine : le modèle fermé et ultra-souverain
- Blocage total des plateformes occidentales comme Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter), Google ou TikTok.
- Elles sont remplacées par des équivalents locaux sous contrôle gouvernemental :
- Douyin (TikTok chinois)
- WeChat (super-app tout-en-un)
- Weibo (réseau social de microblogging)
- Ces plateformes fonctionnent dans un écosystème totalement indépendant du reste du web mondial, avec :
- des serveurs hébergés en Chine,
- un contrôle algorithmique des contenus,
- une modération humaine proactive,
- et une censure stricte des discours contraires à la ligne du Parti.
La Chine incarne une souveraineté numérique absolue, avec un “Internet national” qui ne dialogue que très partiellement avec l’extérieur.
🇷🇺 Russie : vers un isolement numérique progressif
- La Russie suit un chemin similaire depuis la guerre en Ukraine :
- Blocage de nombreuses plateformes occidentales (Facebook, Instagram, X, etc.)
- Promotion de réseaux sociaux nationaux comme VKontakte (VK) et Odnoklassniki.
- Le RuNet (Internet souverain russe) vise à fonctionner même en cas de déconnexion du web mondial.
- Les lois russes imposent :
- la localisation des données sur le territoire,
- la suppression de contenus « illégaux »,
- des pénalités pour les plateformes qui refusent de collaborer.
Le web russe devient un écosystème fermé, aligné avec les intérêts géopolitiques du Kremlin.
🇺🇸 États-Unis : la fragmentation par rivalité économique et sécuritaire
- Le web américain reste global mais de plus en plus protectionniste.
- Le cas TikTok en est le symbole : en 2024, une loi oblige sa revente ou son bannissement pour raisons de sécurité nationale.
- L’enjeu est de limiter l’influence chinoise dans le numérique américain.
- En parallèle, plusieurs États comme la Californie ou le Texas adoptent leurs propres lois sur la modération, la vie privée ou la désinformation.
- Les débats sur la section 230 (qui protège les plateformes de la responsabilité des contenus publiés par leurs utilisateurs) illustrent une réécriture potentielle des règles du web social.
Les États-Unis restent moteurs de l’innovation, mais de plus en plus enclins à régionaliser leur approche du numérique pour répondre à leurs enjeux internes.
🇦🇺 Australie : précurseur d’un modèle de régulation proactive
- En 2021, l’Australie impose une loi obligeant les plateformes à rémunérer les médias pour les contenus diffusés sur leurs réseaux (News Media Bargaining Code).
- Depuis, le pays continue de légiférer sur :
- la modération algorithmique,
- la protection des mineurs en ligne,
- les contenus haineux ou terroristes.
- L’Australie est souvent considérée comme un laboratoire législatif dont les initiatives sont observées (et parfois reprises) par d’autres pays.
Ici, la régulation s’inscrit dans une logique démocratique forte, sans pour autant viser une rupture totale avec le web global.
🇪🇺 Union Européenne : vers un Internet à la norme européenne
- L’UE pousse une régulation structurée, éthique et multiscalaire du web social :
- RGPD (2018) : pilier mondial de la régulation des données personnelles.
- DSA (Digital Services Act, 2024) : impose des règles sur la modération, la transparence des algorithmes, la traçabilité des publicités.
- DMA (Digital Markets Act) : oblige les GAFAM à ouvrir leurs écosystèmes (interopérabilité, non-préinstallation, etc.).
- Ces lois obligent les plateformes à développer des versions spécifiques de leurs produits pour l’Europe :
- TikTok propose une expérience sans recommandation algorithmique pour les mineurs.
- Meta a lancé Meta Verified pour répondre aux exigences locales de transparence.
L’Europe ne cherche pas à couper le web, mais à le rééquilibrer en imposant ses standards éthiques et démocratiques, ce qui crée une forme de ségrégation réglementaire.
🌍 Conclusion
TikTok, Meta ou Google restent accessibles dans de nombreux pays, mais ne sont plus les mêmes selon les régions.
Le contenu, les fonctionnalités, les règles d’usage, les obligations de transparence et de sécurité varient drastiquement.
Ce phénomène n’est pas une censure uniforme, mais une recomposition par le droit d’un web social désormais territorialisé.
Le web global tel que conçu initialement est en mutation profonde.
Ce n’est pas (encore) la fin d’Internet, mais la fin d’un certain idéal universel d’un réseau unique, ouvert et partagé.
On entre dans une ère de “splinternet” — un web fragmenté, multiple, parfois incompatible, souvent géopolitisé, et surtout profondément remodelé par les enjeux de souveraineté, de sécurité et de marché.