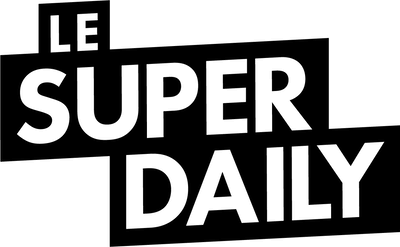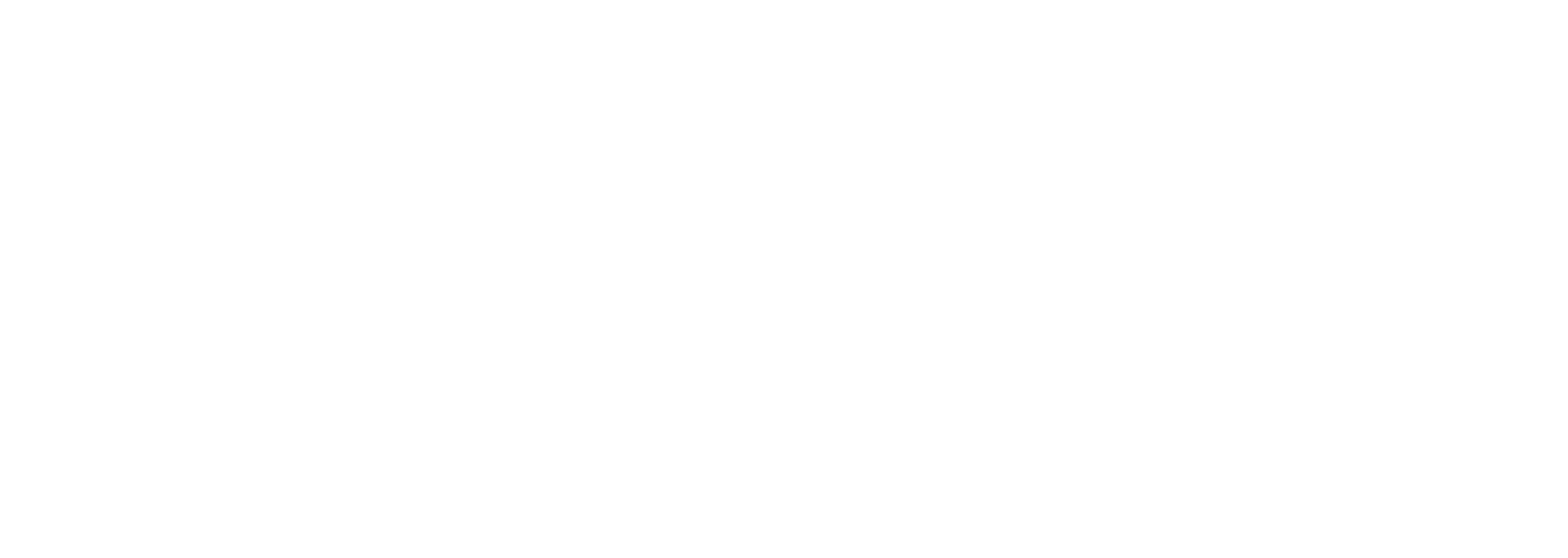Épisode 1372 : Il fut un temps où la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) était partout : dans les campagnes de pub, les posts LinkedIn, les spots TV et les stories Instagram.
Les marques rivalisaient d’initiatives “vertes” : emballages recyclables, chartes éthiques, labels bios, partenariats solidaires… Une vraie course à la vertu.
Mais en 2025, le ton a changé. La communication RSE s’est faite plus discrète, presque silencieuse. Là où hier les entreprises affichaient fièrement leurs engagements, beaucoup semblent désormais en “mode avion” : moins de posts, moins de campagnes, moins de storytelling.
Alors, simple pause ou vrai tournant ?
La RSE en vitrine pendant le Covid
- Crise et sens : Le contexte de la pandémie a servi de catalyseur. Les attentes en matière de responsabilité sociale et de solidarité se sont intensifiées, et les marques ont vu dans la RSE un outil pour affirmer leur rôle sociétal dans une période de fragilité collective.
- Multiplication des prises de parole : Nombre d’entreprises — grandes comme petites — ont lancé des dispositifs “solidaires COVID” (don de matériel, soutien aux soignants, conversion d’activités) et en ont communiqué massivement. Cette posture a contribué à associer très fortement l’idée “d’entreprise responsable” à “entreprise visible” à travers ses valeurs.
- Effet “effet miroir” marketing : La RSE est devenue un argument clé dans les messages de marque, au même titre que le produit ou le service. On a vu fleurir des campagnes “vertes”, des labels, des engagements “durables” mis en avant dans les lancements de produits et les contenus sur les réseaux sociaux.
Fin des effets d’annonce, place à la preuve
Les consommateurs ont atteint un point de saturation.
Ils ont vu trop de campagnes “greenwashing” où l’écologie servait de vernis marketing.
En réaction, une nouvelle ère s’ouvre : celle de la preuve et de la transparence.
Les entreprises crédibles sont celles qui démontrent leurs actions plutôt que de les annoncer.
Cela passe par :
- des rapports d’impact clairs et vérifiables,
- la sobriété numérique dans la communication,
- des actions locales concrètes (plutôt que des campagnes globales creuses),
- des témoignages internes (employés, partenaires, communautés).
Les marques comme Patagonia, Lush ou Greenweez incarnent bien ce virage : elles communiquent peu, mais agissent fort.
Le storytelling devient documentaire : montrer le réel, pas le rêvé.
Greenhushing : quand les marques se taisent pour bien faire
C’est le concept mis en avant par L’ADN : le greenhushing, ou l’art de taire ses actions responsables pour éviter les accusations de “washing”.
Les marques deviennent prudentes, voire silencieuses, face à la peur du bad buzz.
Ce repli n’est pas un désintérêt pour la RSE, mais plutôt un signe de maturité :
👉 Mieux vaut être cohérent que bruyant.
👉 Mieux vaut faire que dire.
Résultat : une impression trompeuse d’un “mode avion” général, alors qu’en coulisses, la transformation continue — plus sérieuse, plus structurée, plus mesurée.
Partie 4 — Réseaux sociaux : de la viralité à la véracité
Sur les réseaux, la communication RSE change de ton.
Fini les grands slogans et les photos de forêts. Place aux contenus pédagogiques, incarnés, factuels.
Les marques adoptent une nouvelle narration :
- moins émotionnelle, plus documentaire,
- moins autopromotionnelle, plus transparente,
- plus locale et plus participative (via les communautés et les collaborateurs).
La RSE n’est plus un levier de viralité, mais un pilier de crédibilité.
Et ça, c’est un vrai tournant pour les social media managers.
Conclusion — Moins de bruit, plus de fond
Non, les marques ne sont pas toutes en “mode avion”.
Elles sont simplement passées à un mode plus réfléchi, plus exigeant, plus responsable.La communication RSE de 2025 n’a pas disparu : elle a mué.
👉 En somme, le storytelling RSE n’est plus une vitrine.
C’est un miroir de vérité.